
22 000 kilomètres séparent Nouméa de Marseille par voie maritime (via le canal de Panama et Gibraltar), et 17 000 kilomètres éloignent la Kanaky de Paris par voie aérienne. C’est cette distance qu’ont parcourus sept indépendantistes enchaîné.es pendant une trentaine d’heures de vol avant d’être conduits dans plusieurs taules métropolitaines, après avoir été raflé.es le 19 juin par les troupes d’élite de l’Etat français. Alors que l’archipel du Pacifique-Sud est parcouru depuis le 13 mai par une insurrection sociale kanak qui a largement échappé à ses dirigeants politiques, ces sept femmes et hommes (et quatre autres) sont accusé.es d’en être à l’origine à travers la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT) *.
Aussitôt connu la « déportation » nocturne par avion militaire des membres de la CCAT, vers une mère-patrie qu’ils conchient et rejettent, inutile de dire que les braises de l’insurrection kanak ont été ravivées de plus belle. La journée de dimanche et les suivantes ont ainsi vu des barrages être (re)montés partout, sans oublier les nombreuses attaques contre les forces de l’ordre ou les incendies qui ont frappé de nouveaux bâtiments institutionnels, commerces ou villas, y compris et de façon notable en dehors du grand Nouméa (c’est-à-dire « en brousse »). De plus, face à cette vague répressive venue la frapper de plein fouet, la CCAT qui a souvent été dépassée par les insurgés ces dernières semaines, a lancé deux nouveaux mots d’ordre dans un communiqué du 23 juin : « les mines [de nickel] resteront fermées », et « nous promettons de fortes perturbations » lors de cette dernière semaine d’élections législatives.

Nouveaux barrages
et incendies
Depuis trois jours et l’intensification des hostilités, on peut recenser de façon non-exhaustive :
- à Dumbéa (grand Nouméa, 35 000 habitants), le commissariat de la police municipale et ses deux véhicules garés dans la cour ont été cramés, tout comme les nouveaux bureaux du Fonds social de l’habitat (FSH). De plus, un des pick-up des forces de l’ordre venu affronter les émeutiers a fait un accident, et s’est rapidement retrouvé encerclé par les insurgés puis incendié à son tour. Dimanche vers 3h, l’école Jack Mainguet a aussi été incendiée : les flammes ont ravagé une partie de la cantine, ainsi que la salle des professeurs et le bureau de la directrice. En tout, pas moins de quatre véhicules blindés de la gendarmerie sont intervenus à Dumbea, dont un Centaure.
- Au Mont-Dore (grand Nouméa, 27 000 habitants), où énormément de commerces et autres ont déjà été pillés et détruits en six semaines et où les européens ne se rendent plus dans la capitale qu’avec l’aide d’une petite navette maritime à cause des barrages, les gendarmes ont encore essuyé des coups de feu en tentant de dégager ces derniers.
- A Païta (grand Nouméa, 25 000 habitants), les destructions ont été très nombreuses : le bâtiment du Détachement spécial d’intervention de la gendarmerie nationale a été réduit en cendres. Idem pour les écoles Ohlen et Gustin (quatre salles de classe, quatre interclasses, deux salles de sieste et deux salles de motricité). Quant au collège Louise-Michel, qui pour une fois porte bien son nom, c’est la salle des professeurs et une salle de classe qui ont cramé. A chaque fois, les pompiers n’ont pu intervenir rapidement, parce que les routes et rues étaient bloquées par les insurgés. Un bateau a aussi été incendié à Port-Laguerre.
- A Koumac (4000 habitants, qui signifie en langue Pwaxumak « Têtes dures/têtus »), située tout au nord de la Grande Terre, c’est la mairie qui a partiellement cramé.

25 juin, La Foa. Incendie de la maison coloniale historique, dite Lacourt - A Fonwhary (commune de La Foa, 3500 habitants sur la côte ouest), c’est une maison coloniale historique vieille de 120 ans qui a été réduite en cendres.
- A Bourail (sur la côte ouest, 5000 habitants), deux grands docks dans le secteur de la zone industrielle de Nandaï (appartenant à Matériaux center et Discount) ont été incendiés et deux villas de colons ont subi le même sort, avec comme point d’orgue des échanges de tirs entre un de ces derniers et des « barragistes ». D’après les gendarmes, les insurgés Kanak sont jusqu’à 300 sur le barrage qui bloque ce village de brousse, une situation « encore jamais vue ». La commune est du coup ravitaillée par la mer, à l’aide du navire scientifique L’Amborella, du gouvernement calédonien.
- A Lifou (îles Loyauté), des insurgés se sont introduits au cours de la nuit sur le tarmac de l’aérodrome de Wanaham, après avoir découpé une clôture. Puis ils ont enflammé de gros pneus sur la piste, ce qui l’a dégradée et a conduit Air Calédonie à annuler tous ses vols à destination de l’île. Et comme le navire qui sert de navette maritime est en carénage jusqu’au 4 juillet, Lifou est donc coupée du reste de la Nouvelle-Calédonie. De plus, du côté de Wé, la seule boutique de prêt-à-porter de la petite île a été incendiée lundi vers minuit.
- A Maré (îles Loyauté), la brigade de gendarmerie à Tadine a été attaquée toute la nuit jusqu’à 4 heures (dimanche à lundi), avec une tentative d’intrusion et des jets de molotovs. Quant au collège de la Roche, il n’a toujours pas rouvert, après avoir été partiellement incendié il y a plusieurs jours.


Du côté des autorités, le couvre-feu (20h-6h) en vigueur depuis le 15 mai est désormais prolongé jusqu’au 1er juillet ; les réseaux de bus (Tanéo) et du transport scolaire dans l’agglomération nouméenne sont toujours suspendus depuis six semaines ; les navettes aériennes entre l’aérodrome de Nouméa et l’aéroport international situé à 60 km ont repris, vu que la route pour s’y rendre est à nouveau jonchée de barrages ; la vente d’alcool qui avait le 10 juin été réautorisée de façon restreinte chez les cavistes pour satisfaire les métropolitains (uniquement les vins et champagnes, d’une teneur inférieure à 18 degrés et dans des contenants d’1,5 litre) tout en empêchant la confection de molotovs avec les bouteilles de bière par les jeunes kanaks, vient d’être totalement interdite depuis le 25 juin ; de très nombreuses écoles ont été fermées après une timide réouverture le 17 juin ; la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie et plusieurs partis loyalistes ont écrit le 25 juin au Président Macron pour lui demander de placer la Nouvelle-calédonie sous tutelle directe, vu la faillite de l’archipel et l’insurrection kanak ; le procureur a ouvert une enquête suite au décès lundi 24 juin d’un jeune Kanak de 23 ans qui revenait d’un barrage dans le quartier de Kaméré (Nouméa), et alors que courent les bruits d’une mort à imputer aux milices caldoches ou aux forces de l’ordre…
Sur la procédure contre la CCAT
Après leur arrestation le 19 juin au matin, les 11 membres de la CCAT ont passé 72 heures en garde-à-vue, puis toutes et tous ont été présentés à deux juges d’instruction du Palais de justice de Nouméa le samedi 22 juin, qui les ont notamment mis en examen pour « association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime » et « participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions de biens » (fait commis du 1er novembre 2023 au 19 juin) ainsi que pour « complicité de tentative de meurtre au Mont Dore, à Nouméa, à Dumbéa et à Hienghène ; vol en bande organisée avec arme, à Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore et Païta ; destruction en bande organisée du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes » (faits commis du 12 au 19 juin pendant l’insurrection). Des accusations qui leur font encourir la perpétuité, pour avoir « défini, préparé, planifié, mis en œuvre un plan d’action violent dans le but de déstabiliser le territoire » selon Yves Dupas, le procureur de la République de Nouméa.
Les juges d’instruction et le parquet ont ensuite présenté leur réquisitions en matière de privation de liberté, puis un JLD les a évidemment suivis : sur les 11 arrêté.es, 2 ont été placés sous contrôle judiciaire (dont Darewa Dianou, fils d’Alphonse Dianou assassiné par les militaires dans la grotte d’Ouvéa en 1988) ; 7 ont immédiatement été mis dans un avion militaire spécialement affrété dans la nuit, pour être incarcéré.es en préventive à 17 000 kilomètres de là ; et les 2 derniers (Gilles Jorédié et Joël Tjibaou, fils du président historique du FLNKS) avaient demandé un débat différé pour préparer leur défense devant le JLD. Aujourd’hui mardi 25 juin, ils repassaient donc devant le juge des libertés, et ont comme les sept premiers été incarcérés, mais cette fois à la prison du Camp-Est (Nouméa)…

En attendant d’en savoir plus, voici déjà les prisons de métropole où ont été incarcérés les sept membres de la CCAT, taules devant lesquelles se sont par ailleurs tenus des rassemblements lundi 24 juin à 18h, à l’appel du MKF (Mouvement des Kanak en France) : Christian Tein est à Mulhouse-Lutterbach (Haut-Rhin) ; Brenda Wanabo Ipeze est à Dijon (Côte-d’Or) ; Guillaume Vama est à Bourges (Cher) ; Steeve Unë est à Blois (Loir-et-Cher) ; Yewa Waetheane est à Nevers (Nièvre) ; Dimitri Qenegei est à Villefranche-sur-Saône (Rhône) ; Frédérique Muliava est à Riom (Puy-de-Dôme).
Précisons également que leur venue provoque déjà des craintes chez les matons, qui ouvrent quelques pistes de réflexion, si on en croit le syndicat FO-matons du centre pénitentiaire de Riom : « ça nous pose un problème sur le plan sécuritaire puisqu’on est un établissement, au niveau de la sécurité, qui est un peu léger. S’il devait y avoir un gros mouvement à l’intérieur ou à l’extérieur, s’il devait y avoir des appels à rentrer dans la prison, ou même une effraction lors d’un transfert par exemple, ça pourrait nous mettre en difficulté. Les détenus médiatiques, c’est toujours embêtant dans cet établissement-là… C’est la gestion avec l’extérieur qui risque de poser des problèmes » (France3, 24/6).
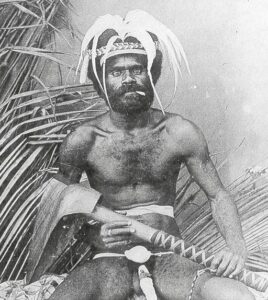
Le « choc » d’une mesure historique
Le choix de l’Etat français de transférer à l’autre bout de la planète des Kanak qui résistent à sa domination rappelle non seulement que la Nouvelle-Calédonie est une colonie de peuplement (avec 21 600 bagnards de métropole qui ont été « transportés » sur place et 3 700 qui y ont été « relégués » à la fin du 19e siècle), mais aussi qu’elle a longtemps été une terre de « déportation » politique dans les deux sens.
4200 communards ont été envoyés au bagne de Nouvelle-Calédonie après 1871, vite suivis par différents révoltés contre la puissance coloniale française : plus d’une centaine de kabyles algériens à partir de 1874, 750 prisonniers (politiques ou pirates) raflés dans le bagne de Poulo Condor en Cochinchine (Viet Nam) en 1891 et quinze autres en 1914 accusés d’avoir commis des attentats contre les commandants français à Hanoï, des comoriens rebelles en 1891 ou encore des Polynésiens opposés à l’annexion française en 1897. Et dans l’autre sens, quand ils n’étaient pas massacrés par milliers, plus de 200 Kanak coupables de refuser l’ordre colonial ont régulièrement été déportés loin de leurs terres entre 1855 et 1929, notamment à Tahiti, dans le bagne du Vietnam, dans les Nouvelles-Hébrides (Vanuatu) et jusque vers Obock, sur la côte des Somalis (Djibouti).
Rappelons aussi que suite à l’adoption par référendum des accords de Matignon (1988) signés entre indépendantistes, loyalistes et l’Etat français, qui avaient mis fin au soulèvement kanak des années 80 (les « Evénements »), un de ses articles comportait une mesure d’amnistie. Le 18 novembre 1988, ce sont ainsi près d’une centaine de prisonniers qui étaient lors sortis de taule, dont 26 insurgés Kanak incarcérés en région parisienne (en préventive pour avoir pris les armes contre les gendarmes et les militaires sur l’île d’Ouvéa). C’est dans ce sens qu’on peut comprendre le choc ressenti sur place, traduit par le communiqué de l’Union calédonienne sorti le 23 juin suite au transfert des membres de la CCAT vers des prisons de métropole : « la déportation de responsables et de militants est une habitude mise en œuvre par la France dès la prise de possession de 1853. Elle est la preuve qu’en 2024, ce pays a recours à des pratiques d’un autre temps ». En occurrence, des mesures carcérales d’exil forcé qui ont une longue histoire et n’avaient plus été mises en œuvre depuis plus trente-cinq ans.

Quant à la CCAT directement, qui a tenu une conférence de presse solennelle à La Conception (Mont-Dore) aujourd’hui 25 juin, c’est peut-être la parole de Jhon-Rock Tindao, président du conseil coutumier de l’aire Drubea-Kapumë, qui la résume le mieux : « Ce grand brasier est un cri de révolte de plus de 10 000 jeunes qui voient leurs rêves d’indépendance s’effondrer avec le dégel du corps électoral... La condition sine qua non pour qu’on puisse apporter un climat de paix, pour qu’il y ait une discussion et que tous les relais CCAT puissent se mettre en berne momentanément, c’est le retour de Christian Tein et de tous les camarades emprisonnés en Métropole parce qu’on estime que ce sont des arrestations arbitraires. »
Tous comptes faits, il semble donc que pour un bon moment encore, le précieux nickel si convoité par l’État français pour alimenter les batteries de son capitalisme vert, un minerai dont regorge la Kanaky, ne soit pas prêt d’arriver à bon port. Ce qui fait au moins une bonne raison supplémentaire d’être solidaires avec les insurgés qui ravagent jour après jour les structures économiques de l’archipel…
* Note sur la CCAT (voir ci-dessous)
[Synthèse de la presse locale et pas que, 25 juin 2024]
NB : cet article fait suite à « Nouvelle-Calédonie : deux journées particulières » (21 juin), « Nouvelle-Calédonie : barrages, sabotages et tambouilles politiques » (14 juin), « Nouvelle-Calédonie : l’insurrection kanak et l’industrie du nickel » (8 juin), « Nouvelle-Calédonie : l’Etat colonial face aux prisonniers kanak » (1er juin), « En Kanaky, rien n’est fini… » (25 mai) et « Le chiffre du jour en Kanaky : 400 et 1 » (21 mai)

* Note chronologique sur les partis kanak et la montée en puissance de la CCAT jusqu’à l’insurrection du 13 mai 2024 :
Le FLNKS (Front de libération nationale kanak et socialiste), créé en 1984, regroupe aujourd’hui quatre principaux partis : l’Union calédonienne (UC), le Parti de libération kanak (Palika), le Rassemblement démocratique océanien (RDO) et l’Union progressiste en Mélanésie (UPM). Ces derniers cogèrent avec les loyalistes le gouvernement calédonien local et certains intérêts économiques (y compris miniers) depuis les accords de Nouméa en 1998, et sont souvent contestés par une partie de la population kanak pour leur corruption ou leur éloignement de l’objectif de l’indépendance, notamment par les jeunes urbanisés de Nouméa, voire leur intégration progressive au système occidental-capitaliste par d’autres (notamment en tribu).
En novembre 2023, est créée la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT) sur une initiative de l’UC lancée à son congrès à l’île des Pins, à laquelle se sont jointes six organisations indépendantistes extérieures au FLNKS : les syndicats USTKE (Union syndicale des travailleurs kanak et exploités, créé en 1981 et membre du FLNKS de 1984 à 1989) et CNTP (Confédération nationale des travailleurs du Pacifique, scission du premier datant de 2016), le Parti Travailliste (créé en 2007, proche de l’USTKE), le MOI (Mouvement des océaniens indépendantistes, créé en 2019 et composé de wallisiens et futuniens vivant en Kanaky), Dynamique Autochtone et la Dynamik Unitaire Sud (DUS, scission du Palika datant de 2011).
De leur côté, les trois autres partis du FLNKS avaient déjà créé en 2020 un Comité nationaliste et citoyen (CNC), là aussi pour élargir leur base (à l’occasion du 2e référendum local sur l’indépendance), ce qui a conduit la CCAT et les CNC a travailler ensemble à partir de novembre 2023 en mobilisant l’ensemble des kanak dans les tribus et à Nouméa, pour empêcher le gouvernement français de réformer le corps électoral local, gelé depuis l’accord de Nouméa (1998). En décidant d’ouvrir ce dernier à des milliers de métropolitains arrivés en Kanaky depuis cette date, l’État s’estimait en effet sorti de la période des accords de Nouméa qui prévoyait trois référendums d’autodétermination, et ont respectivement donné 43% pour l’indépendance en 2018, 47% pour l’indépendance en 2020, et on s’en fout combien en 2021 puisqu’il a été boycotté par les Kanak (alors en période de deuil des morts du covid-19).
La phase 1 de cette mobilisation contre le dégel du corps électoral a d’abord consisté à organiser des manifestations pacifiques, qui ont ainsi grossi au fur et à mesure, passant de 3000 personnes fin novembre à 15 000 le 28 mars, jusqu’à en atteindre environ 60 000 personnes le 13 avril à Nouméa (pour 270 000 habitants dont 41% de Kanak). Devant le succès grandissant des manifestations, le 42e Congrès du FLNKS a finalement décidé en mars 2024, soit deux mois avant le début de l’insurrection, de s’ouvrir à toutes ces autres composantes indépendantistes, et un groupe de travail avait été mis sur pied pour modifier la charte du Front.
Puis est arrivée la phase 2 des mobilisations, nommée « 10 jours pour Kanaky », dans la semaine précédent le vote sur le dégel à l’Assemblée Nationale (celui au Sénat s’était produit le 2 avril), qui devait se tenir le 13 mai et faire adopter définitivement ce projet de loi . Il y a alors eu plus de manifestations pendant cette période, certaines mines de nickel ont commencé à être bloquées, et une grève de l’USTKE a paralysé les ports et les docks, mais aussi l’aéroport de Nouméa. Enfin, la phase dite « 2,5 » a commencé le dimanche 12 mai, avec l’objectif de monter des « barrages filtrants » sur tout l’archipel, en perturbant notamment l’économie de la capitale Nouméa. Sauf qu’à partir du lundi 13 mai, un peu à l’image (toute relative) du mouvement des gilets jaunes où des groupes auto-organisés bloquaient de jour des ronds-points et partaient la nuit cramer des cibles qui leur semblaient adéquates, tout s’est accéléré.
A Nouméa et ses banlieues, où la jeunesse urbanisée kanak est à la fois dégoûtée des partis politiques indépendantistes et subit plus que toute autre misère, racisme et humiliations, l’étincelle du passage en force de ce fameux dégel a explosé en une insurrection sociale marquée par des incendies et des pillages tous azimuts. Le 16 mai, le nombre d’insurgés était estimé à environ 10 000 par les autorités (5000 dans le grand Nouméa, soit Dumbea, Mont-Dore et Païta/ et 4000 dans la capitale). La CCAT, le FLNKS , les autorités coutumières, l’USTKE ou l’Union Calédonienne ont alors eu beau dénoncer les destructions et pillages ou appeler au calme, en tentant de le faire appliquer sur les barrages, rien n’y a plus fait jusqu’à aujourd’hui, causant 1,5 milliards d’euros de dégâts en ruinant une économie néo-calédonienne déjà fragilisée par la chute drastique des cours du nickel. Quant à l’État français, il a eu beau décréter l’état d’urgence entre le 15 mai et le 28 mai, en signant 33 ordres de perquisitions administratives (OPA) et 29 assignations à résidence dont 25 contre des membres du CCAT (soit « 10 leaders mafieux de ce groupuscule qui commet meurtre et pillages » d’après le ministre de l’Intérieur) ou envoyer 3500 flics et militaires sur place, l’insurrection est toujours en cours depuis sept semaines.
Enfin, le 15 juin 2024, un mois après le début de l’insurrection, se tenait le 43e Congrès du FLNKS à Koné, qui était censé intégrer les six nouvelles composantes. Face à la présence de près de 300 membres de la CCAT venus en nombre, qui avaient tenu leur première assemblée générale à Bourail et entendaient bien s’y faire entendre comme représentants des « barragistes » et de la base en lutte sans se contenter de leurs 10 places attribuées, le congrès du FLNKS a finalement été reporté au bout de quelques heures.
Et dernière précision, lors du passage éclair du Président Macron en Kanaky le 23 mai dix jours après le début de l’insurrection, il avait rencontré plusieurs composantes indépendantistes de la Nouvelle-Calédonie, c’est-à-dire non seulement les partis du FLNKS, mais aussi Christian Tein de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), malgré son assignation à résidence. Un mois plus tard, fort de la duplicité liée à tout pouvoir (a fortiori colonial), il a décidé de l’expédier au fond d’une lointaine geôle, avec six de ses camarades…




